Suspension de la réforme des retraites : conséquences pour l’âge légal et le nombre de trimestres
Publié le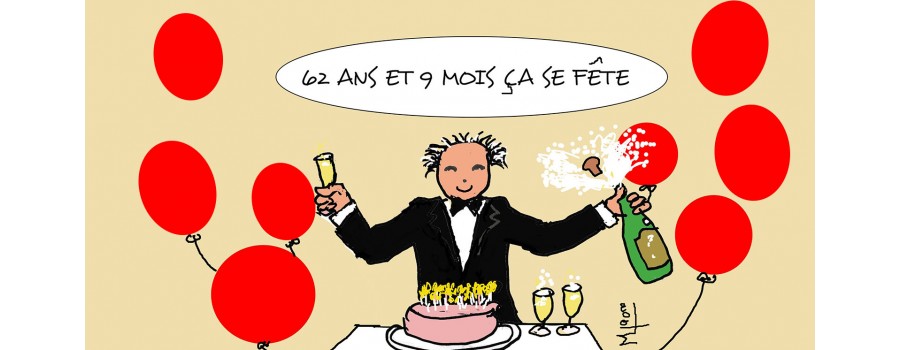
Une suspension, pas un retour à 62 ans
Contrairement à ce que certains croient, la suspension de la réforme des retraites n’a pas pour effet de ramener l’âge légal de départ à 62 ans.
Il s’agit d’une suspension — et non d’une abrogation — de la réforme de 2023, laquelle prévoyait un recul progressif de l’âge de départ à raison d’environ trois mois supplémentaires par an jusqu’en 2030, pour atteindre 64 ans.
Depuis le 1er janvier 2025, l’âge légal est fixé à 62 ans et 9 mois : c’est cet âge qui serait gelé jusqu’aux élections présidentielles de mai 2027, sous réserve de l’adoption effective de la mesure de suspension dans la loi de finances pour 2026.
Les salariés concernés
Cette suspension concernerait principalement les salariés nés après 1963, qui pourraient partir dès qu’ils atteignent 62 ans et 9 mois, en principe jusqu’en 2027.
Ainsi, par exemple, un salarié né le 1er août 1965 pourrait partir le 1er mai 2028, à 62 ans et 9 mois, au lieu de 63 ans et 3 mois selon la réforme initiale.
Toutefois, le délai réel pourrait être plus long, car il est peu probable qu’un nouveau président élu mette immédiatement fin à la suspension d’une réforme aussi contestée.
Une nouvelle loi serait nécessaire, ce qui prendrait plusieurs mois.
Le nombre de trimestres : un gel partiel
Il faut distinguer l’âge légal — qui permet de demander sa retraite — de l’âge du taux plein, atteint lorsque le salarié a cotisé le nombre de trimestres nécessaires.
La réforme de 2023 a prévu une période transitoire pour allonger la durée d’assurance, passant de 168 trimestres en 2023 à 172 trimestres en 2030 (43 ans de cotisation).
La suspension provoquerait un gel temporaire sur la période 2025-2027 : pendant cette phase, les salariés disposant de 170 trimestres pourraient partir à taux plein, alors que la réforme en exigeait 172 pour une retraite prise en 2027.
Pourquoi le taux plein est essentiel ?
Partir à taux plein est crucial, car la décote en cas de départ anticipé est lourde :
- 1,25 % par trimestre manquant,
- dans la limite de 20 trimestres, soit une réduction maximale de 25 %.
Un salarié peut donc subir une perte de 6,25 % pour 5 trimestres manquants, ou 25 % pour 20 trimestres ou plus.
Heureusement, à 67 ans, tout salarié bénéficie du taux plein automatique, même s’il n’a pas cotisé le nombre de trimestres requis.
Les Français face à la réforme : entre lucidité et rejet
Les Français savent qu’il faut adapter le système de retraite à l’évolution démographique : la population vit 30 ans de plus qu’en 1930.
Mais la France reste le pays européen où l’âge de la retraite est le plus bas, à 62 ans et 9 mois, ce qui pèse lourdement sur les finances publiques, d’autant que les pensions françaises sont relativement élevées par rapport aux salaires d’activité.
Pour autant, le véritable problème n’est pas l’âge de départ, mais la sortie prématurée des seniors du marché du travail.
En moyenne, les Français cessent de travailler à 60,4 ans, contre 63 ans dans la plupart des pays européens, et 66,5 ans au Danemark.
60,4 ans : l’âge qui fâche
Cette moyenne cache de fortes inégalités :
- les salariés qui travaillent jusqu’à 64 ans sont relativement préservés,
- mais ceux qui sont écartés dès 56 ans et ne retrouvent pas d’emploi vivent un cauchemar.
Après 27 mois de chômage, beaucoup tombent dans le « halo autour du chômage » : sans emploi, sans revenu, trop jeunes pour la retraite.
Certains vivent sur leurs économies pendant plusieurs années.
Les cadres, souvent entrés tard sur le marché du travail, n’atteignent le taux plein qu’à 66 ou 67 ans.
La France souffre ainsi d’une véritable discrimination structurelle envers ses salariés âgés.
Des entreprises guidées par la logique financière
Ce phénomène s’explique aussi par la structure du capitalisme français, dominé par de grands groupes et des fonds d’investissement.
Pour optimiser leurs coûts, ces entreprises se séparent massivement de leurs salariés âgés, notamment des cadres, dont la rémunération a augmenté avec l’expérience.
Dès 50 ans, beaucoup vivent dans une peur diffuse d’être écartés.
Cette insécurité fragilise la fin de carrière et alimente la mise à l’écart systématique des seniors, en contradiction totale avec les discours publics appelant à « travailler plus longtemps ».
Mettre fin à la discrimination : quelles solutions ?
-
Éviter les erreurs du passé
Il faut éviter les mesures contre-productives comme la loi Delalande des années 1990, qui imposait une pénalité financière en cas de licenciement d’un salarié âgé.
Loin de protéger les seniors, elle a bloqué leur embauche pendant près de vingt ans.
-
L’index senior : une piste prometteuse
La Première ministre Élisabeth Borne avait instauré un index senior, obligeant les entreprises à publier la part de salariés âgés dans leurs effectifs, avec des sanctions financières à la clé.
Ce dispositif, inspiré de l’index égalité femmes-hommes, aurait pu être un outil efficace de transparence et de responsabilisation.
Mais le Conseil constitutionnel l’a censuré, estimant qu’il n’avait pas de lien direct avec la loi de financement de la Sécurité sociale.
-
Miser sur la formation et la valorisation de l’expérience
Le meilleur moyen de lutter contre la discrimination n’est pas de sanctionner les entreprises, mais de les convaincre de l’intérêt économique et humain de conserver leurs salariés âgés.
Cela suppose de former régulièrement les salariés tout au long de leur carrière, et non seulement à partir de 50 ans.
La Finlande a montré la voie : en investissant massivement dans la formation continue des seniors, elle a reculé spectaculairement l’âge de cessation d’activité.
Il n’y a aucune raison que des salariés bien formés soient considérés comme moins performants du seul fait de leur âge : leur expérience constitue un capital inestimable pour l’entreprise.
Conclusion : vers un nouveau contrat social
La suspension de la réforme des retraites offre un répit temporaire, mais ne règle pas le problème structurel du rapport entre travail et vieillissement.
Tant que les entreprises continueront à écarter les salariés avant 60 ans, toute réforme des retraites restera socialement injuste et économiquement illusoire.
L’enjeu, désormais, n’est plus seulement de fixer un âge légal, mais de rendre le travail durable et accessible jusqu’à la retraite.
Cela passe par une révolution culturelle dans la gestion des carrières et par une réconciliation entre expérience et performance.
C’est à ce prix que la France pourra, enfin, sortir du cycle sans fin des réformes des retraites.


